« Le Corinthians sera l’équipe du peuple et le peuple formera l’équipe ». Prononcée par le premier président du Sport Club Corinthians Paulista en 1910, la phrase résume ce qu’est le club à son origine. Plus d’un siècle après sa fondation par la classe ouvrière dans le cœur palpitant de São Paulo, le Timão demeure l’équipe du peuple.
Numéros 10 : Zé Maria et Wladimir

Zé Maria à droite, Wladimir à gauche. Ensemble, ils ont tout connu. Les années noires du Timão, la défaite honteuse en finale du Paulistão 1974 fatale à Rivellino, « l’invasion corinthiane » de 1976, la fin de la malédiction en 1977, « la démocratie corinthiane » et même une sélection en commun sous le maillot de la Canarinha[1].
Quand le Corinthians l’arrache à Portuguesa, Zé Maria est un discret champion du monde 1970, confiné dans un rôle subalterne, doublure invisible du flamboyant capitaine Carlos Alberto[2]. Défenseur plus physique que technique, Super Zé est là pour restaurer la grandeur du Timão aux côtés de l’idole corinthiana, Rivellino. Des places d’honneur lors des Brasileirão 1971 et 1972 augurent de beaux lendemains très vite démentis par de cinglants échecs, dont celui traumatique en finale du championnat paulista 1974. Ce soir de défaite face à Palmeiras, Zé Maria le vit en compagnie de Wladimir, enfant du club et titulaire sur le flanc gauche.
Désillusion, lassitude, désenchantement… Terreaux fertiles des lointains triomphes des années 1950, le Pacaembu et le Parque São Jorge sont désormais des terres putrides où se décomposent invariablement les germes de renouveau du Timão. A la fin de l’année 1976, encouragée par quelques résultats flatteurs, la Fiel torcida[3] se mobilise pour mettre fin à la malédiction. En demi-finale du Brasileirão, le Corinthians se rend dans l’antre de Fluminense et de Rivellino, consacré idole de Rio après son excommunication de São Paulo. Depuis les temps les plus lointains, jamais une telle transhumance n’avait été vue : plus de 70 mille supporters alvinegros investissent le Maracanã et assistent à la qualification des leurs pour la finale, le tir au but décisif étant l’œuvre de Super Zé. Célébrée comme la victoire du peuple face à l’opulent Fluzão, l’ « invasion corinthiane » occulte la défaite en finale contre l’Internacional de Falcão, ultime prolongement de la malédiction du Timão.

Une thérapie de désenvoûtement et le retour d’Oswaldo Brandão sur le banc provoquent un électrochoc. Coach du dernier titre paulista du Corinthians en 1954, Brandão est également le technicien du grand rival Palmeiras au début des années 1970, quand le Verdão truste les trophées sous la férule de son duo Dudu-Ademir da Guia. Débarqué de la Seleção en 1977, Brandão prend les rênes du Corinthians en cours de saison et applique ses vieilles recettes faites de rationalité et de discipline. Sans esbroufe, plus métronomes que géniaux, Zé Maria et Wladimir conquièrent le titre paulista après 23 ans d’attente.
La nation corinthiane revit, elle attire des personnalités comme le Doutor Sócrates, Amaral, Biro-Biro ou Casagrande et s’approprie à nouveau le Paulistão en 1979 contre Ponte Preta. L’occasion pour Super Zé de faire corps avec la torcida en jouant avec une arcade sourcilière ouverte, le maillot maculé de son sang, allégorie primaire de la souffrance quotidienne des classes populaires composant le supportérisme corinthiano dont Lula, dirigeant du Parti des travailleurs, est déjà la figure emblématique.
L’émergence de la démocratie dans le football aurait-elle pu naître ailleurs qu’au Corinthians ? Encouragés par la nomination au poste de directeur sportif d’Adilson Monteiro Alves, un sociologue progressiste, Zé Maria, Wladimir, Casagrande et Sócrates prennent le pouvoir en 1981 et décident collectivement des grandes orientations relevant du domaine sportif. Pied de nez à la dictature militaire au pouvoir, la démocratie corinthiane démontre qu’il existe une alternative à l’autoritarisme et s’impose à deux reprises dans le championnat paulista. En amont du sacre de 1983, les joueurs vont encore plus loin dans la provocation et pénètrent en tenant une banderole sur laquelle est écrit « Ganhar ou perder, mas sempre com democracia ». Après la victoire, O Doutor, Casagrande et Wladimir avec le brassard de capitaine saluent le public (photo de garde). Zé Maria n’est plus parmi eux. A 34 ans, ses vieilles jambes ont crié grâce. Plus jeune de cinq ans, Wladimir poursuit l’aventure même quand tous « les démocrates » ont quitté le club et il détient aujourd’hui encore le record du nombre de matchs disputés sous le maillot alvinegro.
[1] Lors d’un match soporifique qualificatif à la Coupe du monde 1978 en Colombie (0-0) fatal au sélectionneur Brandão.
[2] Il est titulaire lors de la Coupe du monde 1974 et l’aurait probablement encore été en 1978 sans une blessure peu avant le début de l’épreuve.
[3] La torcida Gaviões da Fiel est créée en 1969 et compte rapidement des dizaines de milliers de membres.
Numéro 9 : Jaú

Longtemps, la diversité culturelle du Brésil ne s’exprime qu’avec une extrême parcimonie dans l’univers du football. L’acceptation des joueurs noirs relève de l’exception et si le Corinthians accueille dès 1919 Asdrúbal Cunha, alias Bingo, il traverse la décennie suivante en misant avant tout sur des joueurs issus de l’immigration italienne et portugaise. Cela change dans les années 1930, quand plusieurs clubs majeurs ouvrent sans restriction leurs portes aux Noirs. C’est le cas du Timão confronté à l’exil romain de ses meilleurs Oriundi en 1930 (Filò Guarisi[1], De Maria, Del Debbio et Rato à la Lazio) et au difficile virage vers le professionnalisme. Jaú participe alors en leader à la renaissance corinthiana. Plus encore, au même titre que Fausto, Leônidas ou Domingos da Guia à Rio, il figure l’avènement du multiculturalisme dans le football paulista, donnant une portée exhaustive à l’autoproclamé slogan du Corinthians, o Time do povo, l’équipe du peuple.
Révélé au sein du confidentiel Scarpo de São Paulo, Euclydes Barbosa porte le maillot du Corinthians à partir de 1932. Joueur particulièrement endurant, Euclydes Barbosa s’éclipse rapidement derrière Jaú, un surnom flatteur et vrombissant emprunté à l’hydravion avec lequel un équipage brésilien traverse pour la première fois l’Atlantique-sud sans escale en 1927. Célébré pour avoir résisté à une tentative de corruption avant un derby contre Palestra Itália, il s’installe comme le taulier de la défense du Timão et accueille en grand frère deux autres cracks de couleur, le milieu Brandão et le prolifique artilheiro Teleco. Ensemble, ils conquièrent le titre paulista en 1937, ouvrant une nouvelle ère faste du Corinthians sept années après le dernier titre alvinegro.
Jaú personnifie donc l’intrusion du multiculturalisme dans le football brésilien pour sa couleur de peau mais aussi pour son mysticisme alors que les rites afro-américains sont persécutés par la dictature de Getúlio Vargas. Sérieusement blessé à la tête au cours d’une rencontre, Jaú est évacué en dehors des limites du terrain. C’est alors qu’il reçoit un message céleste. Négligeant l’empressement du soigneur, il s’agenouille, regard perdu vers l’infini, à l’écoute d’instructions divines. Il arrache ensuite des brins d’herbe, les applique sur la plaie sanguinolente avant que le massagista n’enturbanne son crâne. Puis il pose le front au sol, se redresse et reprend le jeu. Il vient de se convertir à l’umbanda, une religion syncrétique, variante du candomblé, le culte pratiqué par ses ancêtres esclaves.
Jusqu’à la fin de sa carrière, du Corinthians – qu’il quitte en 1938 – à Santos, où il raccroche, il précède chacune de ses entrées dans les stades de ce geste de vénération. Retiré des terrains, il est consacré prêtre umbanda. Rien ne détourne Jaú de son sacerdoce, même quand la dictature militaire prend le pouvoir en 1964, oppressant à nouveau les religions afro-brésiliennes et leurs serviteurs.
Son nom revient dans l’actualité au cours des années 1970 alors qu’année après année, le Corinthians accumule les désillusions depuis le dernier titre paulista conquis en 1954. Pai Jaú (Père Jaú) prétend alors qu’une grenouille, ensevelie sous la pelouse du Parque São Jorge, est à l’origine de l’anathème frappant le Timão. Hostile au culte umbanda, engagé dans une relation conflictuelle avec Jaú mais acculé par la torcida, le président alvinegro Vicente Matheus finit par recourir aux services d’un prêtre. Comme dans un conte extravagant, une nuit pluvieuse de 1977, le pai de santo extrait de terre une grenouille, des dents, des mèches de cheveux et des bougies. Le 13 octobre de cette même année, le Corinthians met fin à la malédiction en remportant le Paulistão.

Si l’histoire corinthiana chérit l’histoire de Pai Jaú, qui se souvient du joueur ? Le héros immortalisé dans les années 1930 s’appelle Teleco, meilleur buteur du championnat paulista à cinq reprises mais jamais porteur du maillot national (la légende prétend que des négligences administratives et l’absence de passeport le privent de matchs avec la Seleção). De leur côté, les internationaux Brandão et Jaú – capitaine lors du championnat sud-américain 1937 disputé en Argentine et remplaçant de Domingos da Guia durant la Coupe du monde 1938 en France – ont disparu des mémoires du grand public.
[1] Champion du monde 1934 avec l’Italie.
Numéro 8 : Luizinho

En janvier 1996, le Corinthians dispute une rencontre amicale contre Curitiba en prévision de l’ouverture du championnat paulista. Malgré la pluie battante et l’absence d’enjeu, le public s’est déplacé en nombre au Pacaembu. Au moment de l’entrée des artistes, la caméra s’attarde sur un petit homme au crâne dégarni trottinant jusqu’au centre de la pelouse gorgée d’eau. Poursuivi par une flopée de radioreporters, il flotte dans un maillot orné du numéro 8, bien trop grand pour son corps décharné. Sollicité sur le coup d’envoi, il effectue quelques gri-gris face à un adversaire aussi massif que passif, réalise une passe de deux mètres, perd un ballon et c’en est fini. Sur les prises de vue panoramiques, on le voit errer au milieu du terrain, dépassé par les événements alors que sur les gros plans, son visage émacié et ses mèches de cheveux filasseux plaquées sur le front font pitié. A la cinquième minute de jeu, la Fiel Torcida gronde de plaisir : entouré de journalistes, o Animal Edmundo, recrue phare du Timão, se prépare à faire ses premiers pas. Le vieillard hésite un instant, comprend la consigne et se dirige vers le bord du terrain. Une accolade sans chaleur précède l’entrée d’Edmundo, numéro 8 dans le dos, lui aussi. Le concepteur de la mise en scène pensait probablement bien faire, flatter l’égo d’Edmundo et rendre hommage à une légende corinthiana, Luizinho, 65 ans. Dans les faits, cela s’apparente à un enterrement de première classe.
Avec « le démocrate » Wladimir et le pionnier Neco, Luizinho incarne la fidélité au Corinthians. Dénicheur de talent, Gentil Cardoso propulse ce gamin formé au club en équipe première en 1949, juste avant que ne s’ouvre l’ère dorée du Timão. De 1950 à 1954, avec Cláudio et Baltazar, ils composent un trio inarrêtable où chacun tient un rôle particulier : le meneur excentré Cláudio excelle à la passe, Baltazar marque à profusion et Luizinho dribble à l’infini. Trois titres paulistas, autant de tournois Rio-São Paulo et la petite Coupe du monde des clubs 1953[1] matérialisent la domination du Corinthians du début des fifties.
Désireux de monnayer ces succès, les dirigeants du Corinthians organisent une longue et triomphale tournée en Turquie et dans les pays nordiques en juin-juillet 1952[2]. De ce voyage, l’attaquant de poche du Timão revient riche d’un nouveau surnom : O Pequeno Polegar, Le Petit Poucet. Confronté à la force primitive des défenseurs scandinaves, Luizinho sollicite toute une palette de feintes et impressionne un journaliste manifestement sensible à la morale du conte de Perrault dans lequel l’enfant le plus malingre d’une fratrie échappe par la ruse aux appétits de l’ogre.
A ses dons de funambules, Luizinho ajoute une qualité qui fait chavirer le cœur des supporters du Corinthians : l’irrévérence, en particulier face à Palmeiras qu’il se plaît à martyriser[3]. Car il existe deux Luizinho : celui extrêmement discret en dehors des terrains, dont l’attitude se conforme à son physique de gratte-papier, et celui foulant les pelouses, un diable sorti de sa boîte, créatif et sanguin. Appelé sous le maillot auriverde entre 1955 et 1957, il connaît son heure de gloire en inscrivant le but victorieux du Brésil lors d’un match de Copa 1956 face à l’Argentine.

Quand Pequeno Polegar revêt une dernière fois la tunique alvinegra, en janvier 1996, cela fait 30 ans qu’il a raccroché. Les supporters ont entretenu la mémoire de ses exploits, les enjolivant au fil du temps. Comme cette provocation vis-à-vis de Luís Villa, le rugueux volante de Palmeiras qu’il aurait dribblé avant de s’asseoir sur le ballon en regardant sa victime. Une version que ne corrobore aucun témoin oculaire mais inscrite dans l’historiographie du Timão, justifiant la mise en scène symbolique au cours de laquelle le Petit Poucet souffreteux et sénescent transmet ce qu’il lui reste de pouvoirs à Edmundo, celui qui incarne la vitalité et les espoirs de beaux lendemains. Luizinho vient alors de boucler la boucle. Il s’agit de sa dernière apparition publique, il meurt deux ans plus tard à la suite de problèmes respiratoires.
[1] Titre obtenu face à la Roma et au Barça de los cinco copas emmené par Kubala
[2] Une défaite en 16 matchs.
[3] Il est l’auteur du but victorieux contre Palmeiras offrant le Paulistão 1954 au Corinthians alors que São Paulo fête les 400 ans de sa fondation. Au total, il score à 19 reprises dans le Derby.
Numéro 7 : Marcelinho Carioca

Durant l’été 2004, le président de l’AC Ajaccio Michel Moretti se met en quête de bonnes affaires pour pérenniser la présence des Corses dans l’élite. On ne parle pas encore de data, c’est l’ère de la débrouille pour les clubs sans moyens. Des intermédiaires lui font parvenir des cassettes VHS sur lesquelles des Brésiliens enchaînent les buts et les gestes techniques. Les montages sont manifestement convaincants puisque quatre Sudaméricains signent à Ajaccio. Parmi eux, André Luiz, ancien international du Corinthians ayant évolué à l’OM et au PSG. Et Marcelinho Carioca. La plupart des journalistes sportifs français ne lèvent même pas un sourcil en apprenant son arrivée. Et la suite leur donne raison. A bientôt 33 ans, Marcelinho distille son talent au ralenti : des frappes somptueuses, des passes millimétrées mais en marchant. Physiquement à la rue, il ne survit pas à l’arrivée de Courbis sur le banc en octobre et retourne au Brésil alors que la saison des châtaignes ne fait que débuter[1]. Après Valence, Ajaccio est le second échec européen de Marcelinho, archétype de l’artiste brésilien, fêtard invétéré se reposant sur ses dons, pour qui l’exercice physique s’apparente à une compromission.
Repéré à Madureira, Marcelinho est encore un enfant quand Telê Santana le lance dans un Fla-Flu au cours duquel Zico se blesse prématurément. Avec une nouvelle génération de Meninos da Gávea encadrée par Júnior, il conquiert le Brasileirão en 1992 et se voit affublé d’un surnom qui dit tout de ce qu’il est : « Pied d’ange ». Le désamour avec Flamengo débute quand il échoue sur tir au but en finale de Supercopa Libertadores 1993, offrant le titre au São Paulo FC de Santana. Transféré contre son gré au Corinthians, il va écrire avec son pied droit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire alvinegra.
Orpheline de Neto, o Xodó da Fiel (le Chouchou de la Fiel), la torcida reporte son trop-plein d’amour sur Marcelinho Carioca. En huit saisons avec le Timão (interrompues par un bref passage au sein du Valencia de Claudio Ranieri), il conquiert quatre championnats paulistas, deux Brasileirão et le premier Championnat du monde des clubs, surenchère de la FIFA pour succéder à feue la Coupe Intercontinentale. De son petit pied droit (il chausse du 36), il expose une technique parfaite dans le jeu et sur coups de pieds arrêtés, dont un coup-franc mémorable dans le Derby paulista de 1995. Numéro 7 dans le dos, certains voient en lui le successeur de Cláudio, l’ailier-meneur du Corinthians des années 1950 célébré pour ses buts et ses passes décisives.

Si le Corinthians connaît de grands succès par la suite, notamment un Brasileirão avec Carlos Tévez en 2005 ou encore une Copa Libertadores et un second Championnat du monde des clubs en 2012 avec Paulinho[2], aucun joueur de ces périodes ne peut prétendre intégrer un Top 10 du Corinthians. Après Sócrates, après Neto[3], le dernier crack adulé du peuple corinthiano s’appelle Marcelinho Carioca, n’en déplaise à Rolland Courbis et aux supporters de l’AC Ajaccio.
[1] Son bilan à l’AC Ajaccio : deux buts magnifiques en 10 matchs.
[2] 1-0 face à Chelsea en finale.
[3] Neto aurait pu figurer dans ce Top 10. Joueur spectaculaire, il est décisif dans le premier Brasileirão conquis par le Corinthians en 1990 et succède à Sócrates dans le cœur des supporters.
Numéro 6 : Gilmar

Gilmar, de 1951 à 1961, ce sont trois titres paulistas avec le Timão, deux tournois Rio-São Paulo et un sacre mondial en Suède avec la Seleção. Pourtant, le plus grand gardien brésilien de l’histoire est fréquemment omis quand il s’agit de désigner les cadors ayant défendu les couleurs du Corinthians. Comment peut-on citer Cássio, le goleiro des récents triomphes alvinegros, ou Buster Keaton Dida sans leur préférer Gilmar ? Probablement parce que son nom rime avec Santos, comme s’il n’avait jamais quitté sa ville natale. La présence numineuse de Pelé à ses côtés éclabousse d’une lumière dorée les trophées conquis avec le Peixe à partir de 1961 et relèguent dans l’ombre les succès du Corinthians des années 1950.
Enfant de Santos, Gilmar évolue à Jabaquara, un club désargenté et apatride depuis la cession de son stade de bord de mer à un promoteur à l’affût de la bonne affaire alors que la ville portuaire est en pleine expansion. Jabaquara produit malgré tout quelques cracks, des aliments pour les grands clubs paulistas. L’ambitieux président du Corinthians Alfredo Ignacio Trindade y fait ses courses et sa première bonne affaire a pour nom le buteur Baltazar. Gilmar le rejoint en 1951 presque par hasard. Impliqué dans un deal entre dirigeants, il n’est même pas désiré par le staff des Corinthians. Le Timão tutoie alors les sommets et peut compter sur un jeune goleiro du cru, Luiz Moraes, alias Cabeção. Sa popularité est réelle, sans doute la plus importante depuis Satanas Tuffy, le fantasque gardien de la fin des années 1920.
Mais puisque Gilmar est là, l’entraineur-joueur Newton Senra le lance en équipe première en mai 1951. Débute alors une longue cohabitation avec Cabeção sans qu’aucun des deux hommes ne s’impose véritablement. Gilmar finit par prendre le pouvoir en profitant des faiblesses de son rival lors des rencontres nocturnes, de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que les stades se dotent d’éclairages. Débarrassé de la présence encombrante de Cabeção, il ne cesse de progresser et la conquête du Paulistão 1954 face à Palmeiras lui doit beaucoup. Désigné « gardien suprême du sacre du quadri centenaire » en référence au 400e anniversaire de la fondation de São Paulo, Gilmar est prêt pour de plus grandes conquêtes.
Bien qu’appelé en équipe nationale dès 1953, Cabeção – encore lui – le supplante dans un rôle de doublure de Castilho pour la Coupe du monde en Suisse. Mais à partir de 1955, Gilmar écrase toute concurrence tant son envergure, sa souplesse et son calme rassurent ses défenseurs. Auteur de grandes performances sur le chemin du sacre planétaire 1958 – aucun but encaissé lors des quatre premiers matchs – le grand public découvre son physique athlétique et son visage aux trait délicats, un idéal de beauté grecque. Qui n’a jamais vu cette photo, Pelé sanglotant sur l’épaule de Gilmar, impérial, cheveux impeccablement rangés et regard de braise dirigé vers l’horizon ?

Quand il s’octroie un second titre mondial, en 1962, Gilmar n’est plus le goleiro du Corinthians depuis l’année précédente. Accusé par ses dirigeants de choisir ses matchs et de simuler des blessures, il est cédé au Santos FC où il se constitue un palmarès inégalable dans le sillage du monstre qu’est devenu Pelé.
A suivre…


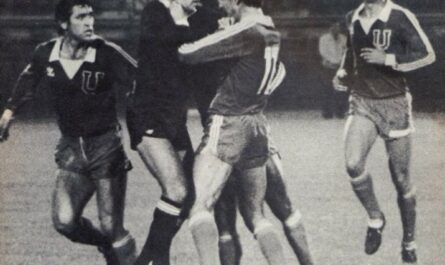


Ola tout le monde
Alors là… je vais me régaler !
Un top 10 du Cruzeiro après ça et je serai comblé
Ah ah, et pourquoi Cruzeiro ? Pour ses origines italiennes, l’ancien Palestra Itália de Belo Horizonte ?
Même pas amigo… J’ai juste toujours eu beaucoup de sympathie pour ce club depuis petit, Ronaldo y est pour un peu, le maillot pour beaucoup.
Dans les années 60-70, il y a du beau monde là bas, Tostão, Nelinho, Dirceu Lopes, Piazza… La Libertadores en 1976 avec Jairzinho. Les frères Fantoni dans les années 20-30 qui font ensuite les beaux jours de la Lazio. Y a de quoi faire un beau top !
Satanas Tuffy? Lol.. Je vais évidemment demander pourquoi on le surnommait (?) Satanas.
Je n’avais jamais réalisé que Gilmar jouât pour les Corinthians.
J’ai passé du temps en Afrique centrale, bref l’histoire impliquant Pai Jau n’est pas de celles à quoi je fermerais trop cartésiènement la porte, le fait est qu’on y entend voire voit de ces trucs parfois.. Que Corinthians renouât avec le titre dans la foulée est quand même très particulier, mais bon, question du candide : la concurrence était-elle solide cette saison-là?
Et n’y avait-il aussi une histoire impliquant Pelé, genre « tant que je joue, ce club-là ne gagnera plus jamais rien »?? ==> C’est apocryphe, ou est-on certain qu’il a bel et bien dit cela à une époque, bien avant ce titre de 77?
Perso, le truc le plus bizarre que j’aie vu, en l’espèce au Congo : c’était, comment dire.. »l’épreuve du balai »?? Je prends le parti d’appeler ça ainsi, en gros : un vol était survenu chez des voisins, personne ne voulut se dénoncer et l’on fit donc venir un sorcier. Lequel disposa au sol des balais faits maison de telle sorte qu’ils forment un passage, dans lequel chaque employé de maison (les domestiques y sont courants), évidemment soupçonné du vol, se devait de passer..
La tension était manifeste parmi eux (et elles), évident qu’ils y croyaient à mort, on ne plaisante pas avec ça (on plaisante si peu que bonne chance pour y trouver le moindre ouvrage en traitant – personne n’oserait en écrire!)………. Finalement, les balais s’agitèrent au passage d’une domestique, qui avoua dans la foulée avoir effectivement été l’autrice du vol.
En bon occidental cartésien, j’ai évidemment envisagé qu’il y eût des ficelles ou que sais-je, un subterfuge, en général je suis doué pour piger les trucs des prestidigitateurs………….mais en l’espèce, ben??? Rien vu, je ne pige toujours pas. Et ce ne sont pas les anciens coloniaux auxquels manquaient ce genre d’histoires, allez savoir.
Satanas car il était apparemment excentrique, portait des rouflaquettes et jouait tout en noir.
Je ne sais pas si Pelé avait lancé une bravade à propos du Corinthians mais dans les faits, Santos est resté invaincu contre le Corinthians pendant 11 années consécutives, de 1958 à 1969.
Rouflaquettes, lol.. Suis en plein dedans. Je viens d’en regarder des photos, il a une bonne tête luciférienne (petit nez crochu, gros sourcils sur un visage d’apparence blafarde..), ça le fait.
Je ne sais plus où j’avais lu ça concernant Pelé, je vais chercher. L’idée est qu’il eût lancé une prédiction/malédiction à la Guttman, genre « vous ne gagnerez plus rien tant que je serai là », un bazar du style………..et, de fait, sitôt pris sa retraite, hop : Corinthians champion. Trop beau pour être vrai sur le coup, non? 😉
Je ne sais pas si Pelé l’avait déclaré publiquement mais on m’a raconté que Corinthians ne gagnait jamais contre Santos quand Pelé jouait. J’ai jamais vérifié la véracité de l’histoire, mais c’est une histoire qui court.
Concernant Tuffy, il était surnommé Satan à cause de ses vêtements noirs et de ses grosses rouflaquettes. Une apparence qui devait détonner à l’époque.
Je me demande comment Verano va boucler son top avec 5 places restantes. En tous cas, Marcelinho 7e, ici, c’est un truc à se faire lyncher. Je crois que j’ai jamais vu un classement corinthiano où il est en dehors du podium. P2F renverse la table !
Ah ah, quitte à me faire lyncher, il n’y aura ni Cássio, ni Tévez, ni Mascherano ou d’autres joueurs du 21e siècle. Peut-être Memphis Depay pourra-t-il prétendre à l’avenir au statut d’idole du Timão ? Tu confirmes, ses débuts sont très bons ?
Bon, ce top 10 n’a aucune valeur et Jaú en est la preuve : il n’a rien à faire là. Mais j’avais envie de l’évoquer, son parcours m’a plu, ça a suffi pour que je le retienne dans ma liste.
Pour la suite du classement, deux noms s’imposent comme des évidences. Pour les 3 autres, il faut se pencher sur l’histoire du club et même sa préhistoire.
Oui, il est monté en puissance de manière assez impressionnante. Il lui a fallu quelques semaines pour se remettre dedans mais il a fini fort, dans tous les domaines d’ailleurs parce qu’il est déjà sur le coup pour une demoiselle de la télé-réalité locale. Il lui a pas fallu beaucoup de temps pour se fondre dans le paysage des joueurs locaux.
Tévez une mégaisaison en 2005 à Corinthians.
Cássio absent c’est blasphématoire. Rien que pour sa ganache à la Courtemanche il mériterait d’y être.
belle série.
le docteur, rivelino et neco comme podium ?
j’ai du mal à voir les deux autres, ce ne sera que découverte tant mieux.
PS: à moins que Emerson Sheik , non ? un doublé en finale de Libertadores ça compte !! je rigole.. mais cette finale de 2012, c’était degueu des 2 côtés, enfin, y’avait 2-3 artistes tout de même
Je relis car c’est dense..et apparemment c’est pas du luxe car le sujet semble l’être aussi, cet enchaînement par exemple, dis donc : « Les années noires du Timão, la défaite honteuse en finale du Paulistão 1974 fatale à Rivellino, « l’invasion corinthiane » de 1976, la fin de la malédiction en 1977, « la démocratie corinthiane » et même une sélection en commun sous le maillot de la Canarinha »
Ils n’ont pas dû se faire chier! Tout cela me paraît amené et développé avec intelligence, du beau boulot Verano, merci!
Marcelinho je connaissais, très fort. Ceux qui ne connaîtraient pas : ça vaut le déplacement, quel joueur.
Egalement été jeté un oeil à leur torcida des 70’s, 2-3 vidéos.. ==> Même pour le Brésil, on est d’accord que c’est particulièrement enlevé comme ambiance, non?
J’ai lu il y a peu un article qui indiquait que les tribunes actuelles n’avaient plus rien à voir avec celles des 70es, à Fla ou au Corinthians notamment. À l’époque, le public reflétait la diversité culturelle brésilienne, les écoles de samba se mêlaient à la torcida et créaient des ambiances géniales. Aujourd’hui, il semble que le public soit essentiellement blanc et bien moins festif.
Tu parles de densité. Tu constateras en lisant la 2nde partie que tout se recoupe : avec cette liste d’évènements, ça nourrit les portraits de Wladimir – Zé Maria et ceux de deux autres joueurs à venir. De même, tu vas retrouver des choses lues sur Luizinho, tout s’entremêle.
Tu as raison à propos de Marcelinho, un pied extraordinaire. Mais j’aime plus encore Neto, un joueur plus mobile, un peu maradonesque jusque dans son tour de ceinture !
Oui, l’on m’avait déjà rapporté cela, pour le Maracana notamment. Mixité football-musique, artistes nombreux.. Une atmosphère sans équivalent possible ni imaginable en Europe, ni hier ni.. ==> Quelle perte..
Et, oui encore : le maillage habile de ton texte le fait ressentir déjà..et l’on pressent que tu n’en as pas fini de faire ton Altman ;), bravo et merci!
Les prix se sont envolés pour maximiser les revenus du stade. Aujourd’hui, les billets les moins chers pour aller voir les grands clubs coutent entre 50 et 100 reais, et le salaire minimal légal ici est autour de 1400 reais. Dans la même idée, il n’y a plus que des places assises.
En tous cas, c’est clairement au-delà de l’abordable pour les revenus modestes.
Au passage, la troisième partie de l’article d’Alexandre sur le Go Ahead Eagles n’est plus en ligne.
D’une manière générale, la droitisation des tribunes suit celle du vote. Au Brésil, en Argentine, en Europe. Les abrutis de barras bravas racistes fans de Milei, y en avait beaucoup moins aussi à un certaine époque.
Merci Verano pour ce top sur Corinthians, qui est à titre perso en 4ème position de mes préférences dans l’état. Apres le Tricolor, Palmeiras ou même Santos. Une histoire hyper intéressante, de grandes figures mais j’accroche moins. Ze Maria, plus physique que technique? Comme quoi je n’avais pas une bonne représentation du joueur.
Dans le genre Bresilien n’ayant pas laissé un passage inoubliable à Valence dans la même période, nous avons l’attaquant Viola. Champion du monde 94. Un mec de Corinthians d’ailleurs.